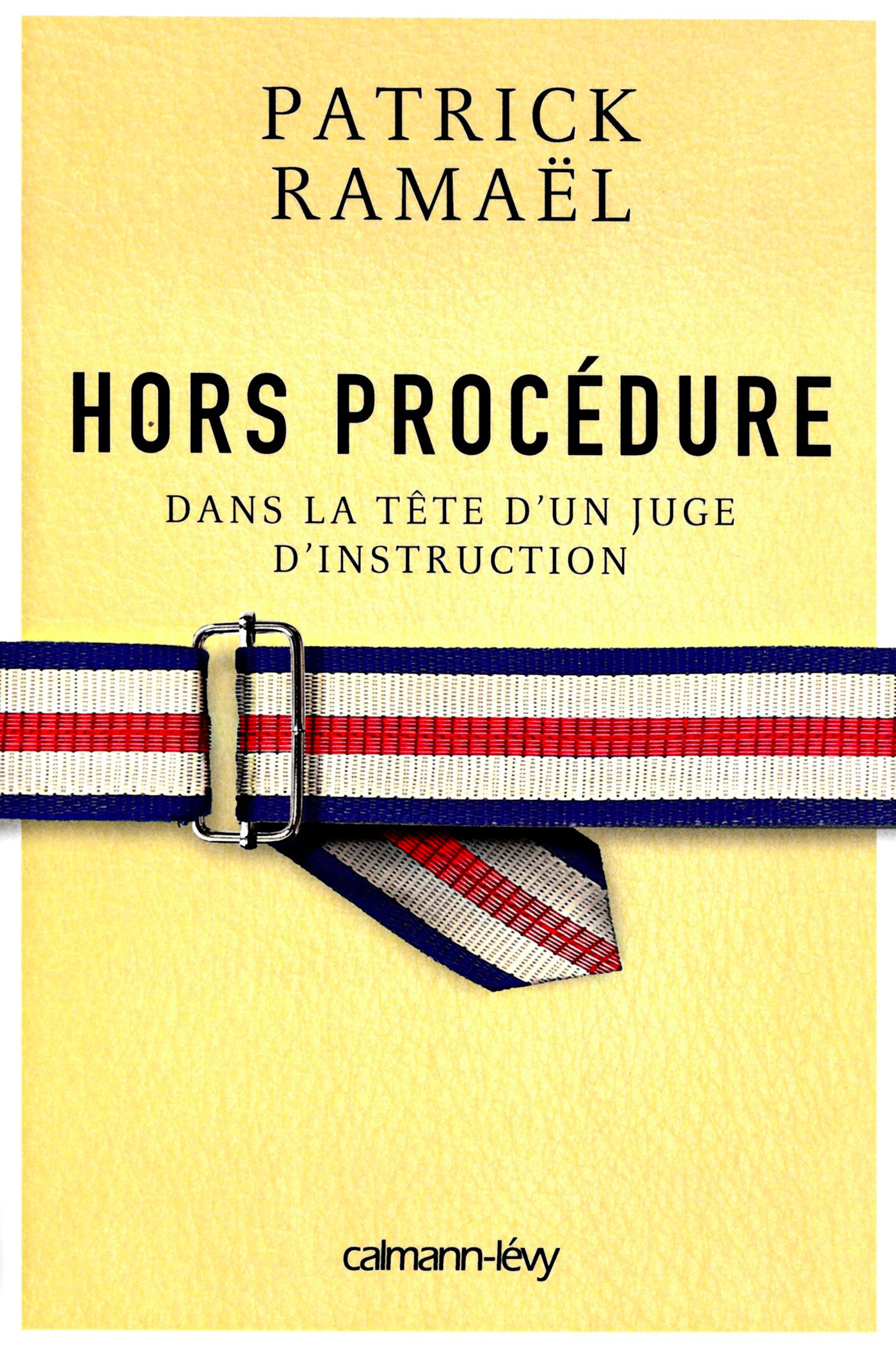Les crimes oubliés des djihadistes de Tombouctou
Esclavage sexuel, torture… Abou Tourab, accusé d’avoir détruit les trésors culturels de la ville malienne, a demandé pardon et plaidé coupable.
Par Marc Leplongeon
Modifié le 22/08/2016 à 13:42 – Publié le 30/03/2016 à 11:20 | Le Point.fr
Pour la Cour pénale internationale (CPI), il s’agit d’une « étape sans précédent ». Ahmad Al Faqi Al Mahdi, alias Abou Tourab, poursuivi pour crimes de guerre, a décidé de plaider coupable et demandé « pardon ». Le touareg malien a estimé, selon un procès-verbal rendu public par la Cour, que les charges retenues contre lui « reflétaient la vérité ». L’événement est historique : jamais chef de guerre jugé par la CPI n’avait jusqu’à présent accepté de faire face à ses responsabilités. Abou Tourab, chef de la Hesbah (brigade des mœurs) de Tombouctou pendant l’occupation de la ville par les djihadistes entre 2012 et 2013, va donc être jugé pour avoir détruit les mausolées de la ville malienne, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Des faits qui, à l’époque, avaient suscité l’indignation sans pour autant inciter la communauté internationale à agir. Le monde avait regardé, consterné, un des joyaux culturels de l’islam tomber aux mains de groupes armés terroristes. Comme il regardera, quelques mois plus tard en Syrie, la ville de Palmyre se faire saccager, et celle de Mossoul, en Irak, partir en fumée…
Ce crime, a précisé Fatou Bensouda, procureur générale de la CPI, « affecte l’âme et l’esprit d’un peuple ». Les « racines » d’une population entière ont été détruites, a-t-elle ajouté. Attaquée dans ce qu’elle avait « de plus intime » : son « identité » et sa « foi ». Mais en acceptant les aveux d’Abou Tourab et en confirmant les charges retenues contre lui, la Cour a également renoncé à mener de nouvelles investigations. Selon des informations du Point, l’homme est pourtant soupçonné de bien d’autres exactions. Et quelque abject qu’il ait été, le crime de destruction de biens culturels pour lequel il va être jugé ne reflète pas suffisamment l’horreur qui a régné à Tombouctou pendant les quelques mois qu’a duré l’occupation djihadiste. Le Point est aujourd’hui en mesure de révéler l’ampleur des abominations commises dans la « cité des 333 saints » par Ansar Dine et Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi). Des scènes de viol et de torture, des détentions arbitraires, des flagellations en place publique… Autant de potentiels crimes de guerre et crimes contre l’humanité qui ont été à ce jour ignorés par la justice internationale. Des femmes enlevées au beau milieu de la rue puis violées alors qu’elles allaient chercher leur pain vêtues de leur tenue traditionnelle ; un frère et une sœur condamnés à douze coups de fouet après avoir juré tous deux qu’ils n’étaient pas amants ; des mères qui ont perdu leur enfant à la suite des traumatismes causés par les violences, etc.
Enlevées, séquestrées et violées
Grâce à un important travail de terrain mené au lendemain de la libération de la ville, la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) a recueilli 70 témoignages extrêmement précis et circonstanciés. Abou Tourab et ses sbires y sont à chaque fois désignés comme les responsables d’exactions commises à l’échelle d’une population. Déposée en mars 2015 devant la justice malienne, la plainte rédigée par la FIDH n’a eu pourtant que très peu d’échos devant la Cour pénale internationale. Un silence que ne comprend pas Florent Geel, chef du bureau Afrique de la Fédération : « Ce à quoi nous avons assisté à Tombouctou, c’est la négation d’un islam pratiqué dans sa diversité. Tombouctou a été le symbole d’une tentative de réislamisation de l’Afrique, à tendance radicaliste et à des buts politiques », explique-t-il.
L’Organisation réclame ainsi qu’Abou Tourab ne soit pas seulement jugé pour avoir détruit des trésors culturels, mais pour avoir imposé la charia à un peuple qui n’en voulait pas ; pour avoir fait de la vie des habitants une longue suite de renoncements au nom d’un islam dévoyé ; pour avoir « commis des crimes contre l’humanité » ignorés par la justice internationale. « La population civile a été délibérément prise pour cible, assure la FIDH, dans le but de la terroriser, de l’asservir, et de pouvoir ainsi exercer un contrôle total sur la ville. » Des faits qu’un témoin entendu par la CPI avait résumés ainsi lors de l’audience de confirmation des charges : « Ils ont détruit tout ce qu’on a. On n’a pas [eu] de force pour nous défendre. »
Une fillette de 8 ans battue avec une cravache
Le travail mené par la Fédération internationale des droits de l’homme repose en grande partie sur une mission effectuée par l’ancien juge d’instruction Patrick Ramaël, aujourd’hui magistrat à Aix-en-Provence, reconnu pour son sérieux. Le juge a mené pendant deux semaines, du 23 février au 2 mars 2015 – soit au lendemain de la libération -, plus de 70 auditions. Les récits qui lui ont été faits des dix mois d’occupation djihadiste sont souvent insoutenables. Leila, 21 ans*, enceinte de quatre mois, raconte ainsi s’être fait kidnapper dans la rue en allant acheter quelques vivres. Ses ravisseurs l’ont emmenée au commissariat, dénudée et agressée sexuellement. Avant de la jeter dans une cellule aux côtés d’autres femmes, qui toutes avaient été arrêtées pour ne pas avoir porté leur hijab. Le chef du commissariat vit encore aujourd’hui à quelques mètres de sa maison.
Bintou et Aicha, toutes les deux âgées de moins de 30 ans, ont été mariées de force, puis séquestrées dans des maisons où, chaque nuit, elle étaient battues et devaient « dormir » avec un homme différent. Au magistrat qui les interroge, elles disent leur calvaire : de l’esclavage sexuel sous la menace des armes. De nombreuses femmes sont tombées enceintes à la suite de ces viols. D’autres, qui devaient bientôt donner la vie, ont perdu leur bébé sous le coup du traumatisme. Rama, 22 ans, a été frappée de 50 coups de fouet pour avoir osé s’asseoir, dans sa maison, à côté de ses beaux-frères. Adama a été séquestrée et fouettée six fois pour ne pas avoir été « convenablement » habillée. Lorsqu’on l’avait enfin libérée, plusieurs heures plus tard, un djihadiste s’était adressé à elle : « Ça, c’est une leçon pour vous toutes. On n’aime pas celles qui ne respectent pas les règles. Gare à toi si cela se reproduit. » En septembre 2012, Damba, une fillette de 8 ans, est cravachée à plusieurs reprises pour ne pas avoir porté de voile. Quelques semaines plus tard, Meryam, enfermée elle aussi pour d’obscures raisons, aura interdiction de faire téter son bébé en cellule.
Des crimes contre l ‘humanité oubliés de la justice internationale ?
Les témoignages, toujours plus effroyables, s’enchaînent. Aucun acte n’est isolé, assure la FIDH. Tous ont vocation à installer la peur partout et à prendre le contrôle du territoire. Le schéma est d’ailleurs toujours le même : les femmes sont enlevées par des « hommes armés à bord de pick-up », dans la rue ou à l’intérieur même de leur domicile. Elles sont ensuite amenées au commissariat islamique, avant, parfois, un passage par le tribunal islamique. Les attaques sont rodées, les violences « systématiques », affirme le juge Ramaël. « L’ampleur des viols et des violences sexuelles », les actes de torture et d’emprisonnement ainsi que toutes les autres formes graves de privation de liberté suffisent à constituer un « crime contre l’humanité », assure la FIDH.
Abou Tourab, chef de la brigade des mœurs, que l’on voit dans un reportage d’Envoyé spécial siéger au tribunal islamique et flageller un couple en place publique, pouvait-il ignorer les exactions commises par ses subordonnés ? On peut vraisemblablement en douter, d’autant plus que deux plaignantes le désignent comme ayant ordonné leur mariage forcé avec des bourreaux. Houka Houka, président du tribunal islamique de Tombouctou pendant dix mois, a été arrêté par les forces françaises en janvier 2014, avant d’être remis aux autorités maliennes. Il a depuis été libéré et vit dans la région de Tombouctou. Sanda Ould Boumama, porte-parole d’Ansar Dine, était présent dans le commissariat de Tombouctou au moment où des exactions ont été commises. Il a lui aussi été relâché le 3 août 2015 par la Mauritanie. Enfin, Hamar Moussa, commissaire de la police islamique de Tombouctou, désigné par plusieurs femmes comme auteur des violences, a fait plus fort encore : l’homme n’a jamais été arrêté et était présent en juin 2015 à Bamako au moment de la signature des accords de paix.
Des « acteurs de guerre devenus des héros de paix »
Comment expliquer que ces hommes n’ont jamais eu affaire à la justice ? « Les accords de paix sont, dans ces cas-là, une grande lessiveuse », assure une source proche du dossier. « On ne lâchera pas avec le temps, rétorque Florent Geel, de la FIDH. À chaque fois, on remet un dossier sur la pile. Ces gens-là finiront bien par tomber un jour. C’est une tragédie pour les victimes qui voient que leurs tortionnaires sont devenus des héros de paix, alors qu’ils étaient des acteurs de guerre. Le pardon ne sera pas accordé sur la base de l’impunité. »
Contactée, la Cour pénale internationale indique que l’affaire Tourab est « la première affaire dans la situation au Mali, et non la dernière ». « L’enquête se poursuit concernant tous les crimes régis par le Statut de Rome commis depuis janvier 2012 », ajoute-t-elle. La CPI précise : « Il est toujours possible, et en fonction de la preuve additionnelle collectée, d’élargir les charges contre un suspect ou alors d’ouvrir une nouvelle affaire. »
* Les prénoms, les âges et certaines situations des plaignants ont été légèrement modifiés afin de garder leur anonymat

 Les échanges d’expérience permettent cette meilleure connaissance des contraintes professionnelles de chacun : les difficultés du terrain et les évolutions des formes de criminalité rencontrées par les policiers, la nécessaire application de nouvelles règles issues d’un environnement juridique qui évolue pour les magistrats.
Les échanges d’expérience permettent cette meilleure connaissance des contraintes professionnelles de chacun : les difficultés du terrain et les évolutions des formes de criminalité rencontrées par les policiers, la nécessaire application de nouvelles règles issues d’un environnement juridique qui évolue pour les magistrats.